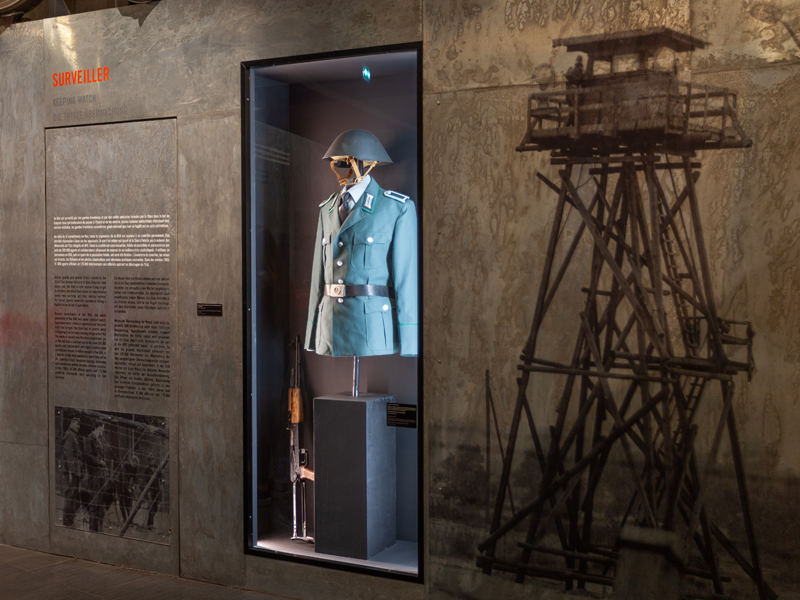La Seconde Guerre mondiale à peine terminée, l’Allemagne bascule dans une période d’antagonismes Est-Ouest. La conquête simultanée de l’Allemagne par les troupes soviétiques et anglo-américaines, qui assurent leur jonction à Torgau en avril 1945, est à l’origine de la division de ce pays durant la guerre froide.
Le froid et la faim tourmentent les habitants. Le Plan Marshall proposé par les États-Unis vient mettre fin à ces difficultés, mais accentue la division provoquée par les secteurs d’occupation : l’unité de Berlin n’est plus qu’une fiction. En Europe, les régions occupées rejoignent peu à peu un camp idéologique : deux blocs se constituent.